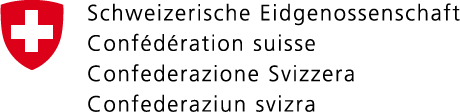L’année 2025 marque un jalon important et symbolique pour l’Organisation météorologique mondiale, qui célèbre les 75 ans de sa création. Trois-quarts de siècle d’engagement en faveur de la science; en faveur d’une meilleure connaissance de notre environnement; en faveur de notre capacité à mieux en anticiper les effets sociétaux et les impacts sur nos vies quotidiennes. Bref: trois-quarts de siècle d’engagement en faveur de l’innovation et du progrès, au service du bien commun.
Le 23 mars 1950, il y a 75 ans, entrait en vigueur la Convention de l'Organisation météorologique mondiale. Trois-quarts de siècles ponctués d’étapes historiques clés pour aboutir à l’écosystème de compétences qui assure la livraison instantanée de prévisions météorologiques de très haute qualité que nous connaissons aujourd’hui.
Parmi ces étapes décisives: il y a eu tout d’abord le recours, dès les années 1960, aux premiers satellites météorologiques, permettant une couverture en temps réel de la Terre. L’utilisation, ensuite, des premiers ordinateurs, grâce auxquels il est devenu possible de calculer les modèles météorologiques numériques complexes, qui constituent l'épine dorsale de toute prévision moderne. Très vite, les avancées réalisées dans le monde de la météorologie sont devenues indispensables pour de nombreux secteurs économiques. Je pense à l'agriculture, à l'énergie, aux transports, ou encore à la protection de la population.
Le rôle de l’Organisation météorologique mondiale a été décisif; il va le rester, et même s’amplifier. D’autant plus dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, confronté à des défis globaux toujours plus complexes, qu'aucun État ne saurait prétendre être en mesure de les relever seul. Et c’est ici que l’importance de l’OMM prend tout son sens.
À une époque où la coopération internationale est mise à rude épreuve, quand elle n’est pas remise en question, le multilatéralisme revêt une importance capitale, vitale. Il doit servir de rempart et d’élan face à l’accroissement des tensions politiques découlant de la montée du protectionnisme, ainsi que face à un certain désengagement dans la recherche collective de solutions aux problèmes qui nous concernent tous, en particulier ceux liés aux enjeux climatiques.
La communauté météorologique prouve que nous bénéficions toutes et tous de la coopération internationale, pour protéger efficacement nos populations contre les risques naturels au niveau local. Et ces risques non seulement s’accentuent avec la recrudescence d’événements qualifiés d’extrêmes, mais aussi ils n’épargnent désormais aucune région du globe.
La Suisse en a fait ces dernières années l’amère expérience. Permettez-moi de vous donner un exemple. En juillet 2023, une supercellule orageuse a frappé la ville de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, avec des rafales de vent atteignant 217 km/h. Cet événement d’une violence inouïe, qui n’a duré que quelques minutes (6’30), a causé des dégâts considérables. Ses coûts dépassent allègrement les 100 millions de francs suisses – soit davantage que le budget annuel de l'OMM!
En Suisse, ce sont dans les Alpes que les conséquences du changement climatique sont les plus perceptibles. La superficie de pergélisol sur le territoire a presque diminué de moitié depuis 1980. Cette fonte accrue déstabilise les parois et les versants, augmentant ainsi le risque de catastrophes naturelles.
Un exemple tragique de ce phénomène est l'éboulement de mai 2025 dans le canton du Valais, où des masses de glace et de roches ont enseveli le village de Blatten. Heureusement, grâce à une surveillance précise, tous les habitants ont pu être évacués à temps.
De tels événements ne sont pas exclusivement dus au changement climatique. Mais la fonte du pergélisol entraînera inévitablement une multiplication des effondrements de glaciers et des chutes de rochers.
Le rôle essentiel de l’OMM
Quel est la place de l'OMM dans ces exemples très locaux? Son rôle est central dans la gestion de ces défis, notamment en appliquant une approche axée sur le système Terre, c’est-à-dire qui prend en compte les interactions complexes et réciproques entre l'atmosphère, l'océan, la cryosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère.
Cette approche scientifique holistique permet de mieux comprendre les dangers naturels et d’élaborer des prévisions plus précises. Sans le travail global de l'OMM, qui met en réseau toutes les composantes du système et encourage l’échange mondial de données, une alerte efficace des autorités ainsi que des organisations de protection civile serait difficile. C'est la seule façon de protéger efficacement les populations au niveau local contre les phénomènes météorologiques extrêmes, très concrètement de protéger les vies, les infrastructures et la vie sociale dans les régions concernées.
Initiative «Alertes précoces pour tous»
La décision du secrétaire général de l'ONU, Monsieur António Guterres, de confier la responsabilité de la mise en œuvre de l'initiative « Early Warnings for All » (Alertes précoces pour tous) à l'OMM témoigne de l'importance capitale de cette organisation. Elle souligne le rôle essentiel de l'OMM au sein du système des Nations Unies, ici, au cœur de la Genève internationale.
Cette assemblée discutera dans les prochains jours de cette initiative. Au cours des deux dernières années, l'OMM a déployé des efforts considérables pour identifier les lacunes dans les systèmes d'alerte de ses États membres et mettre en place des mesures pour y remédier.
Nous sommes conscients du fait qu'il ne s'agit pas d'un sprint de 100 mètres, mais plutôt d'un marathon. Or dans le même temps, le changement climatique entraîne chaque année des phénomènes météorologiques plus fréquents et plus violents, et ce sur l’ensemble des continents. Il est ainsi essentiel de ne pas attendre pour mettre en œuvre cette initiative. Le marathon doit donc être couru à un rythme aussi proche que possible de celui d’un sprint.
Cette semaine, des modifications importantes des systèmes d'alerte précoce doivent être adoptées. Elles renforceront encore le rôle des services météorologiques et hydrologiques nationaux, avec également pour ambition essentielle de combler le déficit de capacités entre les États membres de l'OMM; cet objectif étant – rappelons-le – un des piliers stratégiques de l'organisation.
La mise en place de services météorologiques nationaux performants dans tous les pays doit s’affirmer comme une priorité incontournable. C'est pourquoi la Suisse tient à contribuer à l'initiative «Early Warnings for All», afin de mieux protéger les populations du monde entier contre les dangers liés à la météo et au climat. Je souhaite mentionner deux exemples à cet égard.
Le premier vise à combler les écarts de capacités que je viens de mentionner. Il est porté par l'Agence suisse pour le développement et la coopération (DDC) ainsi que par MétéoSuisse, dans le cadre de projets communs en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Asie centrale et en Europe de l'Est. L’objectif consiste à soutenir les pays – de manière systématique, durable et globale – dans le développement de leurs services météorologiques nationaux. Depuis 2018, ce soutien à long terme est complété par une contribution d'environ 1 million de francs suisses par an à l'initiative CREWS.
Deuxième exemple: le «mécanisme de coordination de l’OMM». Ce mécanisme fournit aux organisations humanitaires les meilleures informations météorologiques possibles, afin de réduire les effets négatifs des événements extrêmes dans les pays moins développés. La Suisse a assumé un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de cette initiative avec le projet «Weather4UN».
Ces exemples illustrent l'engagement fort de la Suisse en faveur du développement de l'OMM. Le Conseil fédéral est fier d'accueillir cette organisation centrale des Nations Unies pour la météorologie, l'eau et le climat. Genève est un écosystème unique d'organisations internationales et d’ONG où l'OMM – en collaboration avec d'autres organisations telles que l'UNDRR, le HCR, l'UIT ou la FICR – peut élaborer des solutions aux défis mondiaux.
Nous vivons une phase de turbulences sans précédent pour le multilatéralisme, que nous ressentons particulièrement à Genève. Les organisations sont soumises à de fortes pressions politiques et financières ainsi qu’à une concurrence accrue d’autres Etats-hôtes potentiels.
Engagement pour le multilatéralisme
J’aimerais réaffirmer ici l’engagement de la Suisse en soutien du multilatéralisme, en faveur du renforcement de la contribution de la Genève internationale à davantage de coopération et en opposition à toute tentative de fragmentation de notre action globale. Cet engagement s’est concrétisé par l’approbation, par le Conseil fédéral le 20 juin dernier, d’un paquet de mesures d’environ 270 millions de francs suisses en soutien du multilatéralisme et de la Genève internationale.
Cet engagement va aussi de pair avec la détermination de la Suisse à renforcer le secrétariat de l’OMM ici à Genève afin de soutenir l’Organisation dans cette période délicate. La Suisse va débloquer 3 millions de francs suisses pour 2025 et 2026 afin d’aider l’OMM à faire face à ses obligations dans le cadre du remboursement de son prêt immobilier. Nous sommes également en contact étroit avec l’Organisation au sujet de mesures de soutien éventuelles supplémentaires, notamment dans le domaine numérique et de l’innovation. La Suisse reste en effet déterminée à offrir à l'OMM les meilleures conditions-cadres possibles à Genève pour mener à bien ses activités.
En ces temps traversés par de grandes incertitudes, nous devons considérer l'OMM comme un phare du multilatéralisme, efficient et performant et nous inspirer de son succès pour préserver et construire un monde plus fort et plus coopératif. Cela vaut également pour les réformes à venir du système des Nations Unies.
Je félicite l'OMM pour son 75e anniversaire et je vous remercie tous, chers membres de l'OMM, cher secrétariat, pour votre travail si précieux, si porteur d’innovation, si reconnu et remarquable, et donc si nécessaire et important.