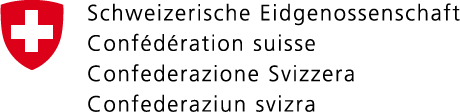11.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
En avril 2023, le Conseil fédéral avait décidé d’ériger au centre de la ville de Berne un mémorial en hommage aux victimes du nazisme. Il estime en effet qu’il est important de perpétuer le souvenir de l’Holocauste, des six millions de Juifs assassinés et de toutes les autres victimes du régime nazi. Sur proposition du Conseil communal de Berne, la terrasse du Casino, située à proximité du Palais fédéral, a été choisie pour la réalisation de ce projet. Un concours est maintenant lancé dans le but de recueillir des propositions d’équipes pluridisciplinaires issues des domaines de l’art, de l’architecture et de l’histoire pour la création de ce lieu de mémoire.
11.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Organisée chaque année depuis 2022, la Ukraine Recovery Conference (URC) vise à coordonner les efforts de reconstruction en Ukraine. Lors de l’édition 2025, qui s’est tenue à Rome les 10 et 11 juillet, le chef de la délégation suisse Jacques Gerber a signé avec l’Ukraine un traité bilatéral instituant une collaboration renforcée avec le secteur privé suisse aux fins de la reconstruction du pays. Divers projets ont en outre été adoptés dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’assurance contre les risques de guerre.
11.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Les 10 et 11 juillet 2025, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a participé à la conférence des ministres des affaires étrangères de l’ASEAN en Malaisie. Sa participation met en évidence l’importance économique croissante de l’Asie du Sud-Est pour la Suisse. Il a profité de cette plateforme pour échanger avec ses homologues malaisien, vietnamien et singapourien au sujet des relations économiques et bilatérales et de la situation internationale. En marge du sommet, il a également rencontré pour la première fois la nouvelle ministre canadienne des affaires étrangères Anita Anand.
09.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis s’est rendu, dans le cadre de son voyage d’une semaine en Asie, au Népal et au Bhoutan du 7 au 9 juillet. Les entretiens officiels menés avec des représentants gouvernementaux ont essentiellement porté sur les relations bilatérales ainsi que sur les perspectives d’une coopération économique approfondie.
08.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Dans un contexte global marqué par le recul de l’Etat de droit, la Suisse travaille avec détermination en faveur des droits de l’homme. Pour cette 59ème session du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies, un accent particulier a été placé sur la promotion des droits des femmes et de l’égalité de genre, ainsi que sur les droits des personnes LGBT. La session, qui s'est clôturée aujourd’hui après trois semaines et demie de débats, a été marquée par une adaptation du travail imposée par les restrictions budgétaires affectant l’ensemble du système onusien.
06.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Depuis ce dimanche 6 juillet 2025, l’Ambassade de Suisse à Téhéran est à nouveau ouverte après avoir été temporairement fermée le 20 juin en raison de l’instabilité de la situation dans le pays. L’ambassadrice Nadine Olivieri Lozano est revenue hier à Téhéran par voie terrestre via l’Azerbaïdjan, accompagnée d’une petite équipe. L’ambassade reprendra progressivement ses activités.
03.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Le conseiller fédéral et chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis se rend en Asie du 7 au 13 juillet 2025. À Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, il assistera à la conférence réunissant les ministres des affaires étrangères des États membres de l’ASEAN. La participation du conseiller fédéral suisse à cette réunion ministérielle témoigne de l’importance économique et géopolitique croissante des pays de l’Asie du Sud-Est. En marge de la conférence, des visites officielles de travail sont programmées au Népal, au Bhoutan, au Brunéi Darussalam et à Singapour.
02.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Remise des lettres de créance des nouvelles ambassadrices et nouveaux ambassadeurs accrédités en Suisse.
02.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Les États de l’AELE (Suisse, Islande, Liechtenstein et Norvège) et ceux du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) ont conclu les négociations en vue d’un accord de libre-échange le 2 juillet 2025.
01.07.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Le 1er juillet 2025, le secrétaire d’État du DFAE Alexandre Fasel a mené une consultation politique à Berlin. Les évolutions géopolitiques actuelles, différents thèmes bilatéraux ainsi que le lancement de la consultation sur le paquet d’accords entre la Suisse et l’Union européenne étaient au centre de l’entretien avec son homologue allemand Géza Andreas von Geyr. Alexandre Fasel a également rencontré à cette occasion le secrétaire d’État de la Chancellerie fédérale allemande Jörg Semmler.
30.06.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Du 30 juin au 3 juillet 2025, la Suisse participera à la Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) qui aura lieu à Séville. Il s'agit d'une conférence mondiale organisée sous l'égide des Nations unies dont l’objectif est de relever les défis financiers afin de favoriser la réalisation des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. La conférence abordera un large éventail de questions de politique de développement, de durabilité écologique, économique et sociale ainsi que de macroéconomie. La directrice de la Direction du développement et de la coopération Patricia Danzi dirige la délégation suisse.
27.06.2025
—
Communiqué de presse
EDA
Pour sa seconde journée d’excursion, le Conseil fédéral, emmené par la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, s’est rendu à Saint-Gall vendredi 27 juin 2025. Il a d’abord visité la Bibliothèque abbatiale, puis il a pris l’apéritif avec la population sur le parvis de l’abbaye.